MENSONGES/RÉALITÉ !

MédiaChartres soutien, plus que jamais, le monde médical.

Alors qu’un énième premier ministre, se réjouit d’avoir fait passer le budget de fonctionnement 2025, pour la France (?) MédiaChartres médite encore, sur ce tour de « passe-passe » réalisé avec, et grâce à des compromis […] et des promesses à tour de bras.

enfumage !
 Une première étape dans le futur grand plan d’austérité, qui se profile à l’horizon.
Une première étape dans le futur grand plan d’austérité, qui se profile à l’horizon.
Une question subsiste, comment en sommes nous arrivé là, et une deuxième (plus intéressante), ou est passé l’argent ?
MédiaChartres apporte des réponses, pour comprendre !
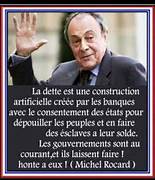
Et pour mieux assimiler, regardez, et SURTOUT écoutez attentivement, Analyses et témoignages :
https://www.youtube.com/watch?v=hcKZ6lXvy-I
Pour les septiques ou adeptes de la « théorie du complot », un petit retour sur une page de notre histoire. Et les similitudes incontestables et glaciales, avec le présent (et l’avenir, proche).
– Face au spectacle dramatique de la dette publique, tout se passe comme si ce problème, parce qu’il est d’actualité serait inédit. A tel point que les solutions proposées à longueur de discours – moins de dépenses et/ou plus de recettes – paraissent novatrices et évidentes.
Or quiconque s’intéresse à l’Histoire ne peut qu’être stupéfait par la similarité des discours d’aujourd’hui et d’hier, en particulier si l’on étudie la dette de la Première guerre mondiale.
D’emblée, il ne s’agit pas de céder à la facilité de dire que l’Histoire se répète (quoique). Ce sont les acteurs de l’Etat qui se répètent. Utilisant les mêmes concepts, ils proposent les mêmes solutions. Seulement, ces mêmes solutions ont conduit à transformer la comédie de la dette publique des années 20 en tragédie des démocraties des années 30.
Après la guerre, la dette publique intérieure est de 178 milliards de francs pour un budget normal de 5 milliards de francs en 1914. Le Gouverneur de la Banque de France pose le problème dans des termes qui n’ont depuis pas varié : « Le retour à [l’] équilibre a pour condition première le remboursement de la dette de l’Etat, remboursement qui dépend lui-même et d’une stricte économie dans les dépenses publiques et de l’effort du pays pour fournir au Trésor des ressources suffisantes ». Partant, le Bloc national peut se faire élire en 1920 avec pour programme « Assainissement des finances publiques, lutte contre le gaspillage, limitation de l’initiative parlementaire en matière de dépenses, simplification des rouages, suppression des emplois inutiles ». La comédie de la dette publique peut commencer.
Lorsqu’il est question de dépenses, « il y a trop de fonctionnaires » (E. Brousse, ch. des députés, 14/12/21). Un sénateur dit : « une politique qui tend à réaliser dans les services publics les économies nécessaires je l’appellerai une politique de réformes. » (20/05/20).
Concernant les impôts : « le système fiscal doit être fonction du système économique. Vouloir faire l’inverse, c’est compromettre le développement du pays, c’est arrêter dans leur essor toutes les initiatives de production » écrit un ministre des finances.
La dette est telle que le Bloc national ne parvient pas à régler le problème. Lorsque la dette occupe la moitié du budget de l’Etat, la réduction des dépenses pour la soutenir impliquerait un hara-kiri étatique. Pour autant, la comédie de la dette mène à une crise de la vie chère qui permettra à la Gauche conduite par Herriot de se faire élire.
Par souci de crédibilité, la Gauche ne remet pas en cause le texte de la comédie qui s’est jouée depuis 1920. Herriot dit « il nous faudra inspirer la confiance, montrer que nous en sommes dignes, montrer que des hommes comme nous, des républicains de gauche sont de bons administrateurs, nous devrons appliquer les principes sans lesquels il n’y a pas d’Etat solide, et, en particulier, le principe de l’équilibre budgétaire ».
Et la comédie pourra se rejouer en dépit de l’alternance politique : « « Nous voici engagés dans un débat dont dépend l’avenir des finances françaises » (28/01/26) « Pour qu’[un patron] ait cette confiance, il ne faut pas le décourager par des impôts excessifs ». (30/01/26).
Là encore, la dette est telle que l’issue de la comédie ne peut mathématiquement pas être résolue par la réduction des dépenses ou l’augmentation des impôts. Mais au lieu de remettre en question les solutions classiques, les acteurs doutent de l’institution parlementaire. Si le Parlement n’arrive pas à résoudre le problème de la dette, le problème c’est le Parlement. Un comité de spécialistes propose ce que l’un deux nomme lui-même une « dictature financière » (E. Moreau).
Poincaré finira par obtenir les pleins pouvoirs en matière financière en 1926. Il signera plus de 80 décrets en moins de 4 mois. On peut sourire de certains : « La situation financière commande, dans tous les domaines, les plus rigoureuses économies. Or, les brigades de gendarmerie à cheval sont d’un entretien coûteux et, dans beaucoup de cas, le gendarme à bicyclette peut remplacer sans inconvénient, le gendarme à cheval » (17/09/26). D’autres sont saisissants tant ils transforment le rôle économique de l’Etat. Le sous-préfet doit ainsi devenir un « animateur » pour faire « l’inventaire nécessaire des ressources économiques » en « promouvant l’organisation et la création des industries » (10/09/26).
Ces mesures ne suffiront encore pas, pour les mêmes raisons. Mais au passage, l’institution parlementaire, et à travers elle la démocratie représentative en est ressortie singulièrement affaiblie.
Malgré l’autoritarisme des décrets, Poincaré ne résout pas le problème avec les méthodes qui avaient été appliquées aveuglement depuis 1920. Ce n’est qu’au bord du gouffre monétaire qu’il finit par accepter que la dette ne pourra pas être payée. Par la loi du 25 juin 1928, 80% de la dette est effacée en divisant la valeur du franc par 5. C’est le miracle Poincaré.
Malgré cette issue, les dix années du joug de la dette avaient tant acculé la société française dans la vie chère et remis en cause les cadres démocratiques au nom des nécessités économiques, que les années 30 pouvaient commencer.
Une courte leçon en forme de souvenir s’impose : les pleins pouvoirs ont d’abord été accordés en France pour des raisons budgétaires. La crise de la dette publique des années 20 a préparé la crise de la démocratie des années 30, en plongeant l’Europe dans l’abime des années 40.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_de_la_France_dans_la_Grande_D%C3%A9pression
Pour aller plus loin : (pour les plus septiques).
En DVD :
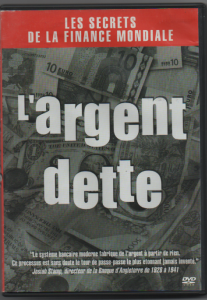
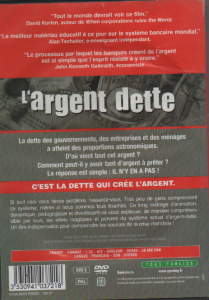

Question de MédiaChartres.
Allons nous revivre, un siècle plus tard, le même épisode (genre, film « Un jour sans fin » ) ?
– La politique c’est comme la mode, un éternel recommencement, rien ne change vraiment –
Martine Leroy